Poussez les portes du laboratoire FRCM et découvrez les cinq installations dédiés à la fabrication et à la réparation de composants métalliques.
Le laboratoire Fabrication et Réparation des Composants Métalliques (FRCM) de la R&D d'EDF, installé sur le site EDF Lab les Renardières, est un ensemble de moyens d’essais de la R&D d’EDF liés à la métallurgie. Il a pour objectif de démontrer l’applicabilité et de qualifier la performance de procédés de fabrication et réparation des composants.
Découvrez la vidéo de présentation des moyens d'essais FRCM
Emmanuelle SCHOENER, responsable du laboratoire vous invite à découvrir les équipes et les moyens d'essais du laboratoire FRCM.
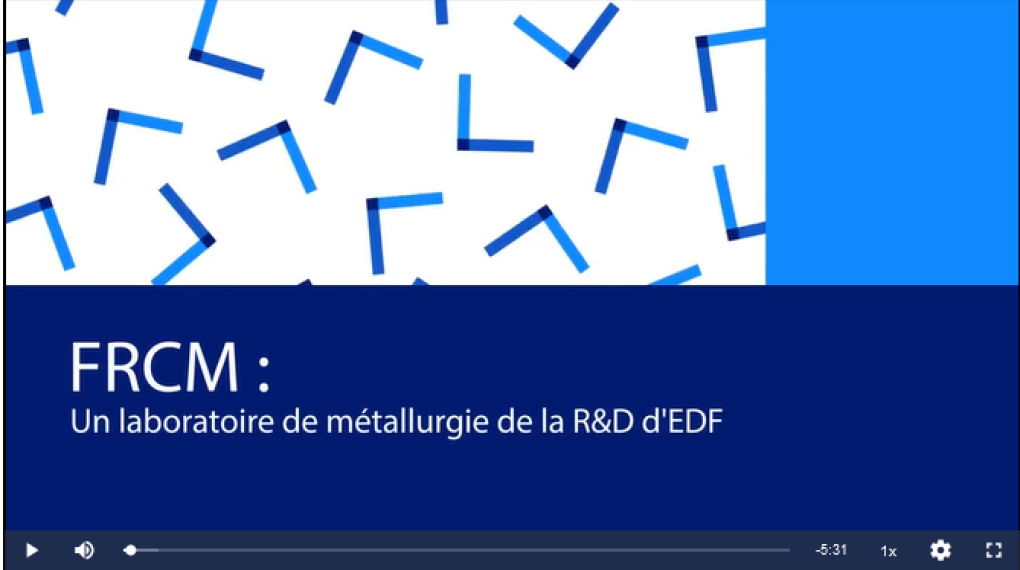
Votre navigateur ne prend pas en compte le javascript.
Pour vous permettre d'accéder à l'information, nous vous proposons de consulter la vidéo FRCM : Un laboratoire de métallurgie de la R&D d’EDF dans un nouvel onglet.
[Ce reportage présente le laboratoire FRCM de la R&D d’EDF, situé aux Renardières, qui teste et qualifie les procédés de fabrication et de réparation de composants métalliques pour le parc de production. La visite est réalisée par Emmanuelle Schoener, responsable du laboratoire FRCM. Elle se déroule à travers cinq installations de pointe — cold spray, scellage sous ampoule de verre, traitements thermiques, soudabilité et simulateur thermomécanique — les équipes explorent l’avenir de la métallurgie au service de la performance et de la durée de vie des installations énergétiques.]
FRCM : Un laboratoire de métallurgie de la R&D d’EDF
Le laboratoire Fabrication et Réparation des Composants Métalliques (FRCM) est un ensemble d’essais de la R&D d’EDF liés à la métallurgie.
Il a pour objectif de démontrer l’applicabilité et de qualifier la performance de procédés de fabrication et réparation des composants.
[On voit arriver Emmanuelle Schoener, responsable du laboratoire FRCM, devant le plan du site des Renardières.]
Emmanuelle Schoener : Bonjour et bienvenue sur le site des Renardières. Aujourd’hui nous allons visiter le laboratoire FRCM. C’est un laboratoire qui travaille sur des pièces issues des moyens de production du nucléaire, en passant par tout ce qui est énergies renouvelables. Il est composé de cinq installations que nous allons visiter aujourd’hui.
[Emmanuelle Schoener se dirige vers un portique de sécurité afin de pénétrer sur le site. Puis nous voyons le site des Renardières vu du ciel avec les différentes installations indiquées : Cold spray, simulateur thermomécanique, scellage sous ampoule de verre, traitements thermiques et soudabilité métallurgique.]
Cold spray
Emmanuelle Schoener : On commence cette visite par le Cold spray. C’est l’installation la plus récente du laboratoire FRCM. Un pistolet va permettre de projeter des particules de poudre métallique extrêmement rapidement sur des composants métalliques représentatifs de nos centrales ou du parc hydraulique pour les réparer.
[Vue de l’intérieur du Laboratoire Cold spray dans lequel Emmanuelle Schoener va à la rencontre de Thibaut et Thomas, ingénieurs chercheurs.]
Emmanuelle Schoener : On va voir Thibaut et Thomas.
Thibaut de Terris : On fait des essais de projection sur des petites plaques comme celles-ci et pour lesquelles on fait varier les différents paramètres du procédé pour voir l’influence sur la qualité des dépôts.
[Thibaut nous montre un écran de contrôle permettant de suivre les essais. Puis, nous voyons le processus effectué par un technicien de laboratoire en combinaison blanche.]
Thibaut de Terris : Par exemple, sur cette plaque, on a fait varier la pression et la température. On va venir les traiter thermiquement éventuellement les couper, les polir. On regarde la microstructure, la densité des dépôts pour pouvoir caler les bons paramètres du procédé et ensuite trouver la recette qui fonctionne pour les dupliquer sur des composants réels.
Scellage sous ampoule de verre
[On retrouve Emmanuelle Schoener dans le couloir d’un autre bâtiment.]
Emmanuelle Schoener : Je vous propose maintenant d’aller visiter l’installation Scellage sous ampoule de verre avec Marion et Christian. Cette installation permet de protéger les échantillons sous atmosphère inerte pendant le traitement thermique.
[On se retrouve dans un laboratoire où l’on peut observer Marion en train de passer un chalumeau sur une longue et fine ampoule de verre.]
Marion : Pour commencer une ampoule, il faut faire un queusot. C’est l’étape qui va permettre de protéger notre échantillon sous une atmosphère protectrice. Une fois que ce queusot est fait, on a une ébauche d’ampoule dans laquelle on va pouvoir insérer l’échantillon.
[On voit Christian travailler sur l’ampoule à son tour.]
Christian : Cette ébauche va être fermée par ce qu’on appelle un fond rond. Notre échantillon va pouvoir être être soudé au bâti de pompage. Ce bâti va permettre de tirer au vide et on va pouvoir ensuite mettre sous 300 mbar d’argon. Cette atmosphère va protéger l’échantillon de l’oxydation pendant le traitement thermique.
Traitements thermiques
[Nous retrouvons Emmanuelle Schoener dans un bureau, dans lequel on peut voir un homme assis face à un écran d’ordinateur. Puis, une porte s’ouvre sur une vaste salle.]
Emmanuelle Schoener : Ici, on est sur l’installation Traitements thermiques du laboratoire, dans la salle de contrôle commande. Cette installation, c’est un parc de 28 fours de traitements thermiques. C’est l’installation historique du département MMC (Matériaux et Mécanique des Composants) puisqu’on a des fours qui ont 50 ans. On a en moyenne 450 coupons qui sont actuellement en vieillissement thermique.
[Emmanuelle Schoener va à la rencontre de Frédéric Delabrouille, ingénieur chercheur et lui présente une pièce.]
Emmanuelle Schoener : Bonjour Frédéric, j’ai récupéré ta pièce, j’ai vu la prestation. On part sur un traitement 200 000 heures à 500 degrés Celsius, c’est ça ?
Frédéric Delabrouille : Oui, c’est une pièce qu’on va faire vieillir 24 ans dans un four, donc un vieillissement thermique de très longue durée. C’est pour la future génération de réacteurs, afin de pouvoir prévoir les propriétés au bout de 60 ans de durée de vie.
Emmanuelle Schoener : On a également une partie de l’activité qui est plus pour les traitements à façon, soit pour les autres installations du laboratoire, le scellage sous ampoule de verre, ou le Cold spray, mais aussi pour répondre à des demandeurs et traiter des grosses pièces.
Soudabilité métallurgique
[Nous retrouvons Emmanuelle Schoener à l’entrée de l’installation Soudabilité métallurgique se présentant comme un immense bâtiment.]
Emmanuelle Schoener : Je vous propose maintenant d’aller voir l’installation Soudabilité métallurgique qui est une grosse installation du laboratoire composée de trois robots : un robot arc flux, un robot TIG et un robot électrode enrobée automatisée.
[Nous nous retrouvons à l’intérieur de l’installation, dans laquelle deux personnes équipées de masques de protection travaillent sur le robot électrode automatisée.]
Emmanuelle Schoener : La petite particularité, c’est que normalement c’est un procédé manuel. Mais là, on l’instrumente pour enregistrer ce qui se passe pendant le soudage.
[Emmanuelle Schoener va à la rencontre de Flore Villaret, ingénieure chercheur.]
Emmanuelle Schoener : Flore, est-ce que tu peux nous expliquer quelles études tu portes au laboratoire et comment fonctionne le Fil flux ?
Flore Villaret : En fait, c’est la machine de soudage à l’arc sous flux. C’est un procédé de soudage qui est très utilisé dans le nucléaire, par exemple pour souder les cuves des centrales. Donc on a un fil métallique qui est le métal d’apport, qui va permettre de remplir la soudure qu’on va faire fondre et protéger par une poudre pour former un laitier par dessus la soudure. Aujourd’hui à la R&D, on étudie ce procédé pour la fabrication additive où on va essayer de construire couche par couche une grosse pièce plus homogène.
Simulateur thermomécanique Gleeble
[Nous retrouvons Emmanuelle Schoener devant la dernière installation du laboratoire : le Simulateur thermomécanique Gleeble.]
Emmanuelle Schoener : Le Simulateur thermomécanique Gleeble, c’est le couteau suisse de notre laboratoire puisqu’il permet de chauffer des petits échantillons très rapidement et de les solliciter mécaniquement.
[Emmanuelle Schoener ouvre la porte du laboratoire et pénètre dans le Simulateur où se trouve Alexis Graux, ingénieur chercheur.]
Emmanuelle Schoener : Alexis, quel traitement thermomécanique tu fais sur la Gleeble ?
Alexis Graux : Je suis en train de me servir de la Gleeble pour simuler une zone affectée thermiquement par le soudage sur un matériau qui est installé sur le parc. J’utilise le principe de l’effet Joule pour faire circuler un courant dans l’échantillon. Cela nous permet d’atteindre des fortes vitesses de chauffage et d’être représentatifs des conditions d’une vraie zone affectée thermiquement par un procédé de soudage.
L’idée, c’est qu’on va tester le matériau dans différentes conditions, avec différents paramètres de soudage et qu’ensuite on va pouvoir analyser l’influence de ces traitements sur les propriétés ou la microstructure des matériaux qui sont installés dans nos installations nucléaires.
Les moyens d'essais du laboratoire FRCM
Cold Spray
Le moyen d'essais Cold Spray réalise des dépôts métalliques en projetant de la poudre à très haute vitesse. Ce procédé de fabrication additive est utilisé pour des applications de réparation de pièces endommagées ou de dépôt de revêtements. En savoir plus
Scellage sous ampoule de verre
L’installation permet de répondre aux besoins de verrerie sur site et d’assurer des délais de réalisation rapides. L'équipe réalise des scellages d’échantillons sous ampoules en Pyrex ou en Quartz, pour la protection des échantillons lors des traitements thermiques. Les matériaux peuvent être scellés sous atmosphère neutre.
Traitements thermiques
Cette installation dispose d’un parc de 28 fours et réalise des traitements à la demande [dits traitements à façon] de courte durée ainsi que des traitements de vieillissement d’échantillons à des températures allant de 285°C à 750°C et pour des durées pouvant dépasser 200 000 heures (environ 23 ans), permettant de couvrir les durées représentatives d’exploitation de nos moyens de production (CNPE). En effet, les traitements de vieillissement visent à anticiper les dégradations/évolutions de certains composants. Pour cela, les conditions de vieillissement sont choisies de telle manière qu’elles permettent d’accélérer le vieillissement des matériaux tout en restant représentatives des conditions/mécanismes de vieillissement en service.
Soudabilité métallurgique
L'équipe de cette installation réalise des études visant à étudier et comprendre les liens entre procédé, métallurgie, défauts et propriétés mécaniques finales, dans le but de faciliter et de fiabiliser les fabrications futures. Cette installation est équipée de trois machines soudage ainsi que de deux banc d’essais pour l’étude de la sensibilité à la fissuration lors du soudage.
Gleeble
Ce moyen d’essai permet de réaliser des traitements thermomécaniques complexes, sous atmosphère contrôlée, sur des échantillons métalliques. Ceci permet de reproduire certains procédés de fabrication en laboratoire, tel que des cycles de soudage ou de caractériser le comportement mécanique à haute température des matériaux métalliques. Cela permet d’obtenir des informations essentielles à la compréhension des évolutions structurales et du comportement mécanique (exemple : problématique du soudage du P355 sur Fla3) et de valider certaines lois de comportement mécaniques.

