Pour EDF, l'atteinte des objectifs de neutralité carbone passe avant tout par la production d'une électricité bas carbone et l'électrification des usages. Mais saviez-vous que la R&D d'EDF s'intéresse aussi aux solutions naturelles de séquestration du carbone, notamment avec le projet CACTUS, piloté par EIFER, qui explore des moyens de maintenir et de renforcer la capacité de la nature à capter et stocker du CO2 ?
Le projet CACTUS, « Séquestration CArbone, fonCier et soluTions natUrelleS », est piloté par EIFER et a pour objectif de construire et de fournir au Groupe EDF une expertise sur la séquestration du carbone dans les écosystèmes naturels. CACTUS vise ainsi à être force de propositions quant aux solutions naturelles à déployer par l’entreprise.
La R&D vous emmène aujourd'hui à la rencontre des équipes qui travaillent sur le projet.

Votre navigateur ne prend pas en compte le javascript.
Pour vous permettre d'accéder à l'information, nous vous proposons de consulter la vidéo La R&D vous emmène à la découverte des solutions naturelles de séquestration du carbone dans un nouvel onglet.
[Ce reportage présente le projet CACTUS, à travers lequel la R&D d’EDF explore des solutions naturelles de séquestration du carbone aux côtés d’EIFER et de partenaires scientifiques. Forêts, prairies ou tourbières deviennent des terrains d’expérimentation pour renforcer la captation du CO₂ tout en préservant la biodiversité et les équilibres territoriaux. Il fait intervenir Loraine ROY (cheffe de groupe Transition énergétique, Marchés et Environnement à EIFER Allemagne), Léa Dieckhoff (ingénieure de recherche, référente scientifique pour le projet CACTUS) et Marie-Laure Rabot-Querci (cheffe de projet CACTUS, EIFER).]
La R&D vous emmène à la découverte des solutions naturelles de séquestration du carbone
Pour EDF, l’atteinte des objectifs de neutralité carbone passe avant tout par la production d’une électricité bas carbone et l’électrification des usages. Mais saviez-vous que la R&D d’EDF s’intéresse aussi aux solutions naturelles de séquestration du carbone, notamment avec le projet CACTUS, piloté par EIFER (European Institute for Energy Research) qui explore des moyens de maintenir et de renforcer la capacité de la nature à capter et stocker du CO₂ ?
Loraine ROY : Dans le projet CACTUS (séquestration Carbone fonCier et soluTions natUrelleS), on étudie la séquestration du carbone dans les écosystèmes : la séquestration naturelle. On va regarder différents milieux : les forêts, les tourbières, les prairies. Ces milieux stockent déjà actuellement du carbone et on peut augmenter cette séquestration grâce à la mise en place d’un certain nombre de pratiques de gestion.
La restauration de la forêt permet par exemple de maintenir ce stock de carbone, mais aussi de contribuer à l’épuration de l’eau, à la lutte contre l’érosion des sols, et à la préservation de la biodiversité.
On va mener des actions de concertation avec les acteurs du territoire et adresser des défis sociétaux majeurs comme l’adaptation au changement climatique.
[L’équipe se rend dans un bâtiment.]
Léa Dieckhoff : Depuis cette année, on a plusieurs sites pilotes qui nous permettes d’enrichir nos travaux avec des données de terrain.
[Zoom sur l’écran d’ordinateur de Léa Dickhoff qui nous montre une carte vue du ciel d’un site.]
Léa Dieckhoff : Là par exemple, on a le premier site qui est le site près de la centrale d’Aramon où on est en train de convertir des cultures annuelles en prairies permanentes.
[On voit des membres d’EDF effectuer des mesures et des prélèvements dans une prairie.]
Léa Dieckhoff : Et à cet endroit, on va suivre l’évolution des stocks du carbone du sol, mais également la biodiversité et l’hydrologie. Et c’est particulièrement important l’hydrologie parce que ça va devenir une zone tampon pour les inondations.
[Un membre d’EDF observe les arbres à l’aide de jumelles dans une forêt.]
Léa Dieckhoff : Nous travaillons aussi sur des sites forestiers comme à Civaux en Nouvelle-Aquitaine, sur un terrain qui appartient à EDF.
[On revient de nouveau sur l’écran de Léa Dickhoff, nous montrant la forêt vue du ciel.]
Léa Dieckhoff : Là, on va tester une technique de laser, le LiDAR terrestre qui nous permet de mesurer le volume de la biomasse forestière.
[De retour dans la forêt, des employés d’EDF mesurent le diamètre d’un tronc d’arbre.]
Léa Dieckhoff : On compare les résultats de ces mesures avec une méthode traditionnelle de mesure du volume de biomasse en forêt basée sur des mesures de diamètre et de hauteur d’arbres.
Un des défis des sites pilotes, c’est la mesure du carbone. Mesurer un stock à un moment donné, c’est relativement facile. Ce qui est plus compliqué, c’est de mesurer une évolution de stock car ce stock évolue très lentement et il faut aussi gérer les incertitudes de mesure. Pour cela, nous travaillons avec des partenaires académiques qui nous accompagnent, comme par exemple l’INRAE de Clermont-Ferrand.
Un autre défi, c’est de ne jamais considérer un seul enjeu lors de la conception et de la réalisation des sites pilotes. Par exemple, la séquestration du carbone ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité.
Marie-Laure Rabot-Querci : On est partis de presque zéro et cela nous a pris plusieurs années pour monter ce projet. Pour nous appuyer sur des fondements scientifiques solides, nous avons constitué une équipe R&D multidisciplinaire, curieuse et débrouillarde pour pouvoir jongler entre les aspects théoriques d’un côté et la mise en pratique.
Aujourd’hui, nous travaillons dans des projets concrets avec des partenaires que nous avons rejoint, notamment dans les territoires et des entités académiques ou scientifiques.
Loraine Roy : La raison d’être d’EDF nous conduit à nous intéresser à ces sujets et à déployer et expérimenter des solutions naturelles qui font partie du panel de pratiques qu’il faut mettre en oeuvre pour construire un avenir énergétique neutre en carbone.
Et à la R&D d’EDF, nous avons la chance de pouvoir travailler sur ces sujets d’avenir.
Un projet sponsorisé par :
RSE & ADAPT - Division Programmes & Stratégie
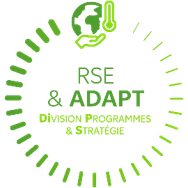
Bon à savoir
EIFER (Europäisches Institut für Energieforschung EDF-KIT EWIV) est un institut indépendant de recherche franco-allemand sur l’énergie fondé par EDF et KIT en 2002, pour renforcer leur collaboration par le biais de projets communs appliqués à des questions industrielles. EIFER propose des solutions énergétiques innovantes bas-carbone en support d’un développement durable des villes, des communautés locales et des industries. EIFER est basé à Karlsruhe et compte plus de cent collaborateurs.
